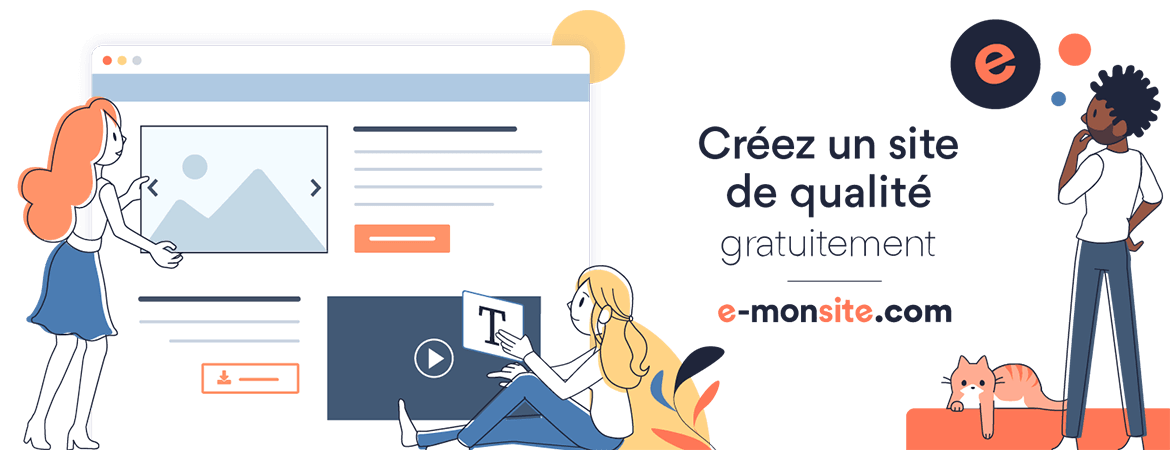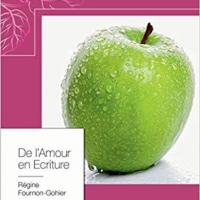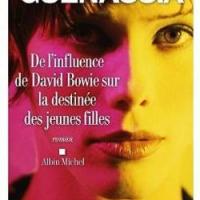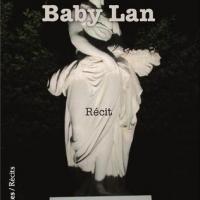- Accueil
- N.L.F et son Evénementiel
- Dans l'entrelacs des possibles d'un archipel
Dans l'entrelacs des possibles d'un archipel
Dans l'entrelacs des possibles d'un archipel, « réhabilitons les puissances du rêve et de la poésie » [ La sagesse des lianes / Cosmopoétique du refuge ]
 Nous sommes arrivés à ce moment crucial où nous devons apprendre à tout réinventer : les concepts, les approches, les habitudes, les méthodes, les outils, les nations, les espaces… tout au jour d’aujourd’hui est à réinventer. C’est la seule possibilité qui nous reste de contourner le cosmocide de notre planète.
Nous sommes arrivés à ce moment crucial où nous devons apprendre à tout réinventer : les concepts, les approches, les habitudes, les méthodes, les outils, les nations, les espaces… tout au jour d’aujourd’hui est à réinventer. C’est la seule possibilité qui nous reste de contourner le cosmocide de notre planète.
Lettre fermée aux gens du Nord et Compagnie, Sony Labou Tansi, 1992.
« Face à la dévastation en cours, réhabilitons les puissances du rêve et de la poésie : cette intelligence du sensible qui bande l’arc en ciel du possible », tels sont les mots du philosophe Dénètem Touam Bona dans ce texte manifeste accompagné par des images de créations de certain.e.s des artistes impliqué.e.s dans une expérience artistique et philosophique qu’il coordonne.
A la suite d’une résidence d’écriture (février-mars 2019) au Centre international d’art et du paysage de Vassivière, le philosophe Dénètem Touam Bona s’est vu offrir une carte blanche pour une grande exposition qui aura lieu de début juillet à début novembre 2021, sous le parrainage de l’Institut du Tout-monde (fondé par Edouard Glissant). Intitulée « La sagesse des lianes / Cosmopoétique du refuge », cette exposition collective et transdisciplinaire existe déjà sous une forme virtuelle [Lire la démarche de ce projet : « La possibilité d’un archipel »].
A travers l’expression « La sagesse des lianes », Dénètem Touam Bona se réfère non seulement à une plante qui joue un rôle fondamental dans certaines cosmologies (en Amazonie, l’ayahuasca ou « liane des morts » incarne l’Esprit de la forêt), mais aussi aux pratiques d’alliance et de solidarité véhiculées par l’expression créole « lyannaj ». La sagesse des lianes, c’est peut-être d’abord cette réunion de singularités dont le tissage improvisé, à la façon d’une jam session, produira forcément des enseignements inédits : Jean-Luc Raharimanana, Bintou Dembélé, Hawad, Florence Boyer, Myriam Mihindou, Soeuf Elbadawi, Nicola Lo Calzo, Isabelle Fruleux, Yvan Alagbé, Hugo Rousselin, Daniely Francisque, Milena Kartowski-Aïach, Véronique Kanor, Jack Beng-Thi, Migline Paroumanou, Sylvie Glissant, Rocé, Latifa Laâbissi, Abdou N’Gom, Julien Béramis, Yann Gaël, Kiltir Maloya… Le collectif Degré 7 poursuivra le projet « Kimboto » avec trois sculpteurs saamaka de Guyane – Kafé Bétian, Ozé Amiemba, Joël Kakaï – dans le cadre de cette expérience « La sagesse des lianes ».
Depuis la fin de l’été 2018, les « grèves scolaires pour le climat » se multiplient dans le monde. A quoi bon aller à l’école si l’eau, l’air, la faune, la flore, les fondamentaux de la vie sont voués, dans un avenir proche, à faire défaut. « Personne n’a envie d’étudier ou de travailler pour un futur qui n’existera pas », déclarent des collégiens. Cri d’alerte, ces grèves inédites sont aussi le symptôme d’une faillite du futur, d’une stérilité de l’avenir, d’une perte de sens globale dont les premières victimes sont les jeunes, selon Trumba_Raharimanana.
 Aperçu d’une installation poétique de l’écrivain Jean-Luc Raharimanana. Travail photographique et vidéo issu d’une réflexion autour du trumba à Mayotte : une cérémonie que l’on ne convoque qu’en temps de crise, crise collective ou crise personnelle, et seulement lorsque les moyens de guérison classiques ont échoué.
Aperçu d’une installation poétique de l’écrivain Jean-Luc Raharimanana. Travail photographique et vidéo issu d’une réflexion autour du trumba à Mayotte : une cérémonie que l’on ne convoque qu’en temps de crise, crise collective ou crise personnelle, et seulement lorsque les moyens de guérison classiques ont échoué.
Réhabiliter les puissances du rêve et de la poésie
Comment parler de l’avenir à ses enfants ? Comment ne pas les angoisser, les tétaniser, les asphyxier, sans pour autant leur mentir ou se voiler la face… Si nous devons prendre acte de l’état alarmant de notre planète, ce n’est pas pour céder au fatalisme, mais au contraire pour rouvrir l’horizon.
La poésie est célébration de la terre, célébration du ciel, célébration du cosmos. C’est un grand « Oui » à la vie, mais c’est justement ce Oui qui nous oblige à dire Non. A témoigner de l’intolérable, de l’immonde, de la destruction du monde : qu’il s’agisse de la 6ème extinction de masse des espèces vivantes ou de la sinistre agonie, sous nos yeux, du droit d’asile.
Face à la dévastation en cours, réhabilitons les puissances du rêve et de la poésie : cette intelligence du sensible qui bande l’arc en ciel du possible. A l’origine de toute spiritualité et de toute spéculation théorique, il y a l’expérience poétique : la saisie du monde comme totalité vivante, l’intuition que tous les éléments qui nous entourent, nous traversent et nous composent – le végétal, le minéral, l’eau, l’air, les ondes magnétiques – se répondent, s’entrelacent et forment un seul et même « cosmos ». La « cosmo-poétique », c’est la forme première de l’écologie : une écologie des sens à travers laquelle chamanes, ngangas, rebouteux et autres maîtres de l’invisible établissent un dialogue obscur, tissé de métaphores, avec l’ensemble de ce qui vibre.

- Arrachement -Incision derrière le paysage- Le travail de Jack Beng Thi porte autant sur la mémoire que sur le territoire, il rend compte de la singularité des paysages afrodiasporiques
Tout paysage est visage
Comment peut-on, aujourd’hui encore, croire que la nature est sans voix et qu’elle n’a pas son mot à dire, quand la première musique est celle de la terre ! C’est en fonction de la rhapsodie des vents et des eaux, des mouvements de terrain, des accidents du relief, de l’humidité ou de la sécheresse, que se modulent les sifflements, les claquements, les cris, les couacs, les bzzzzzz du « grand orchestre des animaux » (Bernie Krause). Et l’ensemble de cette bio-polyphonie forme un paysage sonore, un paysage en fugue, un paysage jazz. Ici, nulle partition écrite à l’avance, plutôt une improvisation, une variation continue qui est celle du vivant lui-même. La vie est artiste, de sorte que les vérités n’ont de sens que resituées dans ce mouvement perpétuel de création. Voilà pourquoi Edouard Glissant, le grand chantre martiniquais des paysages archipéliques, déclare que « rien n’est Vrai, tout est vivant »…
Tout paysage est visage. Les traits d’un territoire renvoient au tracé d’une partition que ses habitants, humains et non humains, jouent et rejouent constamment pour en faire un milieu de vie. Parce qu’elle prend en compte l’infini pluralité des points de vue non humains, la cosmopoétique nous introduit d’emblée à un « plurivers » ondoyant. Dans les cosmologies amérindiennes, aborigènes ou encore bantoues, le rêve ne s’oppose pas à la réalité mais en constitue, au contraire, la dimension la plus profonde : les contours et catégories s’y estompent pour laisser place au courant des métamorphoses. Les rêves, qu’ils soient diurnes ou nocturnes, songes intimes ou mythologies collectives, offrent la possibilité d’expérimenter le monde vécu d’un oiseau, d’un arbre ou d’une rivière, et nous incitent ainsi à nous soucier de ce qui est à la fois au-delà et au-dedans de nous. C’est d’abord à travers les rêves que nous « réalisons » que nous ne pouvons vivre qu’en relation avec d’autres intelligences terrestres.

- Ladjablès, femme sauvage, conte contemporain inspiré d’une légende caribéenne, texte et mise en scène Daniely Francisque, Création 2018 Compagnie TRACK (Martinique)

- « Leros – un Exil Insulaire chez les Damnés : Oratorio en dix chants-témoignages » de Miléna Kartowski-Aïach. LEROS, l’île grecque des damnés, où des générations d’Hommes ont été enfermés, et ont rêvé leur liberté face à la mer. C’est l’histoire de notre temps où des milliers d’êtres menacés s’abîment en Méditerranée sans que nos vies en soient ébranlées.

- Cham de Nicola Lo Calzo « Gerardo de Souza et le masque de la mort sur la plage de Ouidah, au Bénin ». La cérémonie du masque de la mort apparaît à la fin du 18ème s. à Ouidah : elle est introduit par des descendants d’esclaves affranchis du Brésil. Cette photo s’inscrit dans le cadre du projet de création « Cham » qui explore l’Atlantique noir : les mémoires et le présent des mondes afrodiasporiques.
Les frontières lézardent nos vies, modèlent nos imaginaires et nos perceptions
Encore faut-il que nous soyons capables d’humanité, capables de nous reconnaître dans notre prochain, quand bien même serait-il en haillons, d’une autre religion, d’une autre langue, d’une autre couleur. N’oublions pas qu’à la base de toute société humaine, il y a l’utopie concrète du refuge. Bien des cosmogonies mettent en scène des déluges, des exodes, des réfugiés en quête d’une terre promise, et font de l’hospitalité offerte à l’étranger une valeur cardinale. Comment accueillerait-on Moïse aujourd’hui ? Que serait un monde où il n’y aurait plus de refuge ni pour les humains contraints à fuir leur pays, ni pour l’ensemble des vivants menacés par l’exploitation féroce des ressources naturelles. La question de l’asile ne se pose pas seulement pour les dits « migrants ». Nous sommes tous voués désormais à devenir des réfugiés sur nos propres terres ; nous sommes tous en quête d’un sol, d’un air, d’une eau qui ne soient pas souillés ; nous sommes tous en quête d’un « dehors » – un refuge – qui échappe au bouclage cybernétique des espaces-temps (les mille et un traçages et profilages algorithmiques des individus).
Des accès sécurisés des buildings aux contrôles d’identité, en passant par les checkpoints des supermarchés, les frontières ne se limitent plus aux bordures de nos Etats-nations, elles lézardent nos vies, modèlent nos imaginaires et nos perceptions. En pleine guerre froide, Jung établissait une analogie entre la dissociation du monde scindé en deux blocs antagonistes (communiste/capitaliste) et celle du psychisme de l’homme moderne : « Le rideau de fer, hérissé de mitrailleuses et de barbelés, parcourt l’âme de l’homme moderne ». Que dirait-il aujourd’hui ?…

- « Caravane » de Sylvie Glissant. Série « Les traversants » : grands formats, voiles de bateaux, technique hybride : cire , pigments purs, acrylique, huile, pastels gras, encres. « Apparitions de paysages au fil d’une traversée en partage. Au-delà de l’horizon que l’on dévire en frondaisons communes.

- « Bleu au-delà » de S. Glissant
C’est toujours la même « mission civilisatrice » qui dévaste les derniers pans de forêt amazonienne
Comme le souligne Lévi-Strauss, avec l’âge moderne s’est ouvert un cycle maudit : « Jamais mieux qu’au terme des quatre derniers siècles de son histoire, l’homme occidental ne put-il comprendre qu’en s’arrogeant le droit de séparer radicalement l’humanité de l’animalité, en accordant à l’une tout ce qu’il retirait à l’autre, il ouvrait un cycle maudit, et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d’autres hommes. » Ce qui se traduit, en ce début de 21ème siècle, par une prolifération et une « bunkerisation » des frontières régissant les circulations humaines. Une « ligne de couleur » déployée à l’échelle du globe assigne à résidence les populations des Suds (celles dépourvues de comptes en banque dans les Nords), les réduisant au statut de « flux migratoires » : des fleuves sombres et anonymes charriant des risques aussi terrifiants que les dix plaies infligées à l’Egypte par le Dieu de l’Ancien testament – épidémies, terrorisme, « grand remplacement », criminalité, traite des femmes, etc. La guerre en cours à l’encontre des espèces invasives – les « migrants » – s’accompagne, paradoxalement, d’un phénomène inverse : le recul constant de la frontière sur le plan de l’exploitation des ressources naturelles, au point de faire du cœur du vivant lui-même – l’ADN – une marchandise. Le transhumanisme, tout ce bla bla gluant autour de l’« humanité augmentée », ne vise qu’à l’extension du domaine du copyright à la procréation humaine technologiquement assistée (et privatisée). L’assurance de la qualité a toujours un coût, que ne ferait-on pas pour le bonheur de « son » enfant…
 Fleur Canne : installation de la plasticienne et performeuse Migline Paroumanou. Un hommage aux « engagés » qui remplacèrent les esclaves dans les champs de canne et usines, après l’abolition de 1848. Leurs conditions de travail étaient proches de l’esclavage. Les engagés étaient « importés » d’Afrique et d’Asie, d’où l’importance des communautés indiennes, tamoul et chinoise à la Réunion.
Fleur Canne : installation de la plasticienne et performeuse Migline Paroumanou. Un hommage aux « engagés » qui remplacèrent les esclaves dans les champs de canne et usines, après l’abolition de 1848. Leurs conditions de travail étaient proches de l’esclavage. Les engagés étaient « importés » d’Afrique et d’Asie, d’où l’importance des communautés indiennes, tamoul et chinoise à la Réunion.
Aujourd’hui, sous le nom de code « développement », c’est toujours la même « mission civilisatrice » qui dévaste les derniers pans de forêt amazonienne. En effet, dans la plus pure tradition coloniale, Bolsonaro considère les Amérindiens et les Quilombolas (communautés fondées par des « noirs marrons », des esclaves fugitifs) comme inaptes à mettre en valeur leurs territoires. En se les appropriant, grands propriétaires terriens et multinationales ne feraient donc qu’œuvrer pour le bien commun tout en repoussant les frontières de la « sauvagerie »… Le devenir-fasciste du Brésil[1] est intimement lié à l’intensification et à l’extension des modèles coloniaux de la plantation (les plantations de cannes à sucre esclavagistes sont le prototype de la monoculture et de l’agro-industrie) et de l’extractivisme minier (l’« Eldorado »[2] est un des mythes fondateurs de la prédation capitaliste). Se perpétue ainsi le cosmocide des communautés amérindiennes et afrodescendantes, et cela avec la complicité d’intérêts européens (importations de fourrage et de viande, importations de soja et d’huile de palmes notamment pour la production de « biocarburants »)[3].
L’association de l’île au désert est symptomatique d’un désir de désertion de la société
Le fait que le Centre d’art et du paysage de Vassivière se situe sur une île en fait un lieu idéal pour penser, dans le même mouvement, la frontière et le refuge. A l’origine, la frontière est marquée par des traits du paysage : tracé d’un fleuve, d’un col ou d’un rivage, délimitations vaporeuses des zones intermédiaires de type marais ou mangrove, etc. Mais l’île c’est aussi, à l’instar du désert, de la forêt ou de la montagne, un espace de disparition ; un des paysages privilégiés du refuge, en particulier pour les lecteurs et écrivains qui, à l’approche de l’été, doivent toujours répondre à la sempiternelle question : « quels livres emporteriez-vous sur une île déserte ? »… L’association de l’île au désert est symptomatique d’un désir de désertion de la société, qui peut prendre la forme passive et individualiste du « cocooning » (île cocon), mais aussi la forme active et collective d’une expérimentation sociale et politique – l’utopie. Dans Utopia, le livre de Thomas More, le geste de détacher une presqu’île de son continent – en y traçant un canal qui bouclera le cercle d’une nouvelle terre où réinventer l’humanité – constitue précisément l’acte de naissance de l’utopie.
Mais la forme d’une île renvoie aussi à la colonie qui, dès le départ, est conçue comme un isolat – un espace vierge dont la luxuriance évoque le jardin d’Eden -, et partage ainsi avec l’espace de l’utopie la fonction de laboratoire où pourront être expérimentés de nouveaux modes d’exploitation, de gouvernement, de gestion des ressources naturelles et humaines. C’est d’ailleurs dans les îles tropicales – en particulier, sur l’« île de France », l’actuelle Maurice – que les premières politiques environnementales (nourries, entre autres, par des savoir-faire indigènes) ont été mises en œuvre[4] afin de pallier aux ravages engendrés par le système de la plantation, qui mettaient en péril la pérennité même des territoires coloniaux.

- White Dog rend hommage à la stratégie du marronnage, pour déjouer le piège de nos diverses attentes.Convoquant les motifs chers à la chorégraphe Latifa Laâbissi (le camouflage,l’ingestion, la figure toxique), la méthode de White Dog sera celle, puissante, de la fuite et de la fugue comme forme de lutte poétique.Cette stratégie de la fuite et du lyannaj induit une esthétique de la forêt et du tissage

- Aperçu de la création du danseur et chorégraphe Abdou N’Gom, « Nos Mouvements Incessants”, 1er volet du triptyque « YAAKAAR », « ESPOIR » en Wolof. Une création où la parole, l’écriture, leurs aller-retour, du corps à la page, sont centraux.
Des « colonies merveilleuses »
Une des expériences historiques qui manifeste le mieux les rapports ambigus qu’entretiennent espaces utopiques et espaces coloniaux est sans doute celle des missions jésuites du Paraguay (17ème s.) : des « colonies merveilleuses, absolument réglées, dans lesquelles la perfection humaine était effectivement accomplie. (…) La vie quotidienne des individus était réglée non pas au sifflet, mais à la cloche. Le réveil était fixé pour tout le monde à la même heure, le travail commençait pour tout le monde à la même heure ; les repas à midi et à cinq heures ; puis on se couchait, et à minuit il y avait ce qu’on appelait le réveil conjugal, c’est-à-dire que, la cloche du couvent sonnant, chacun accomplissait son devoir », explique avec ironie Michel Foucault (in « Des espaces autres. Hétérotopies », 1967). C’est à partir de tels microcosmes disciplinaires – la plantation esclavagiste en constituant la version la plus féroce – qu’ont pu être perfectionnées des techniques de pouvoir qui seront par la suite appliquées dans les manufactures, les écoles, les prisons, etc. des métropoles impériales.
C’est parce qu’il radicalise la fable coloniale de Robinson Crusoé (1719) – prototype de l’individu moderne, autosuffisant, qui soumet la nature par son travail, tout en civilisant le sauvage Vendredi (par la discipline morale du travail) – que H.G. Wells, avec L’île du Docteur Moreau (1896), inaugure l’une des premières dystopies : le récit de la transformation d’un rêve collectif en cauchemar. Dans cette fiction spéculative, Wells nous décrit une « station biologique » du Pacifique où est poussée à son paroxysme l’expérimentation sur les humains : le Docteur Moreau les hybride en effet avec des animaux. Un texte visionnaire où H.G. Wells se référait sciemment aux « ténèbres » de la colonie et à l’effet boomerang de certaines pratiques coloniales sur les sociétés colonisatrices. La généalogie qui lie – à travers notamment leur concepteur, le généticien allemand, Eugen Fischer qui procéda à des expérimentations médicales sur le « matériel humain » herero et fonda, en 1927, l’Institut allemand d’Hygiène Raciale (Rassenhygien). Il fut l’un des principaux inspirateurs de l’idéologie d’Hitler – les expérimentations médicales d’Auschwitz à celles des camps de Namibie (2ème Reich, autour de 1905) donnera raison à Wells…
« (…) l’action coloniale, l’entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l’homme indigène et justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l’entreprend ; le colonisateur, qui, pour se donner bonne conscience, s’habitue à voir dans l’autre la bête, s’entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C’est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu’il importait de signaler. »
Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1955.

- « Ravaz…sizèr lo swar » – Création de la chorégraphe réunionnaise Florence Boyer. Les « ravaz » (offrandes) sont suspendues dans les arbres après le Servis kabaré (culte aux ancêtres lié aux héritages malgaches et bantous). Il s’agit de nourrir les esprits qui n’ont pas pu se joindre à la cérémonie. Dans cette pièce, ce sont les corps dansant eux-mêmes qui sont donnés en offrande. (c) Gael Écot

- « Prière pour un pays », court-métrage de Soeuf Elbadawi. Ce film part d’une scène de sacrifice, empruntant à l’imaginaire d’un pays déconstruit, les Comores. Les influences arabes, africaines, perses et occidentales, s’y entremêlent dans un rituel composite. L’occasion d’une réflexion troublante sur la désagrégation d’une culture archipélique, et sur les ressources offertes par la création artistique

- Les Indes : Isabelle Fruleux, dans une lecture-performance du grand poème d’Edouard Glissant, « Les Indes ». Avec, de gauche à droite, Eddie Ladoire à l’électroacoustique, Felipe Cabrera à la contrebasse et Sonny Troupé à la batterie.
Les rives d’une île appellent toujours d’autres rives, et des dérives fécondes et inédites.
Contre la conception classique de l’utopie en tant que société idéale dont la perfection ne peut être que totalitaire (cf. dystopies de Zamiatine, Huxley, Orwell), contre la conception coloniale de la géographie qui fait de chaque territoire une enclave « ethnique », rappelons avec Edouard Glissant que « l’île n’est pas un endroit isolé, toute île fait partie d’un archipel ». Entre l’île et le continent, l’archipel est cet espace qui préserve les frontières et l’ouverture, qui permet d’éprouver simultanément le lieu et le monde. L’archipel, c’est une façon de penser poétiquement la « relation », à partir d’un ancrage dans un paysage vécu parce que parcouru.
Justement, lors de mon premier séjour sur l’île de Vassivière, j’ai eu le sentiment d’être dans un archipel comprenant autant d’îles qu’il émerge de singularités pour celui qui parcourt la région. Le plateau des mille vaches était devenu pour moi le « plateau des mille îles » … Et c’est cette vision archipélique (à l’opposé de toute vision identitaire) du territoire comme territoire toujours-déjà hybridé, créolisé, en devenir, que j’aimerais mettre en œuvre, avec d’autres artistes, dans l’exposition à venir « La sagesse des lianes » (été 2021).
Les rives d’une île appellent toujours d’autres rives, et des dérives fécondes et inédites. Pour les Aborigènes d’Australie, tout site paysager (une montagne, un canyon, un point d’eau) est à la fois trace d’une histoire et portail ouvrant sur une constellation d’autres espace-temps (cf. Rêves en colère, Barbara Glowczewski). La « pensée archipélique » (Glissant) à laquelle nous appelons est une pensée texte-île : comme autant de motifs émergeant de la trame d’un multivers, tout texte renvoie à d’autres textes, toute île à d’autres îles, et la terre elle-même à l’infini des astres. De l’île aux cosmos…

- Projet Kimboto, Xylophages, 2014-2017 Sérigraphies des circuits de termites à la surface du tronc Kimboto. Collectif « Degré 7 »

- Makandra, 2017 Forest Art, ONF Guyane Forêt des Malgaches, Saint-Laurent-du-Maroni. Bois de wacapou. Collectif « Degré 7 »
C’est à la sagesse des lianes que rend hommage le terme créole « lyannaj »
Si le jardin ne s’enseigne pas, il est l’enseignant, comme aime à le répéter Gilles Clément, c’est parce qu’il a toujours reposé sur un dialogue continuel entre les humains et les autres êtres animés (insectes, plantes, oiseaux, etc.). Il y a donc des enseignements à tirer du savoir-faire, du savoir-vivre des plantes. Dans le projet « La sagesse des lianes », nous nous intéresserons plus précisément aux lianes, ces lignes de fuite végétales qui, à partir des entités et des matériaux les plus divers, sans plan ni programme, dans une indocile spontanéité, parviennent à composer des univers riches et bigarrés. C’est à cette sagesse des lianes que rend hommage le terme créole « lyannaj » : une expression qui désigne, dans les Antilles françaises, les pratiques d’alliance et de solidarité ainsi que les processus d’hybridation et d’improvisation créatrice (cf. Manifeste pour les « produits » de haute nécessité, 2009, Institut du Tout-monde).
Le lyannaj est né dans les champs de canne où il désignait à l’origine ce doigté, cette dextérité, ce mouvement textile par lequel on cousait ensemble les roseaux sucrés (cannes à sucre) de Babylon. Lyannaj…, ce geste technique essentiel à l’exploitation, à la dépossession, à la vampirisation des corps esclavagisés est devenu, par un étrangement renversement, l’expression créole la plus puissante de la solidarité, de la créativité, des liens qui dé-chaînent : ceux de la poésie, du chant, des sociétés de travail et d’entraide, des cultes et rythmes afrodiasporiques.
Faire de la migration une puissance créatrice
N’ayant à produire ni tronc ni arborescence massive, la liane met toute sa fougue dans l’ascension vers la lumière – la source de vie. Ce fil vivant trace une ligne ondulée qui part de la chair humide et opaque des sous-bois pour rejoindre le drapé d’émeraude de la canopée. Mais l’échappée vers les cieux de la liane n’est possible que parce qu’elle compte sur les autres, que parce qu’elle se mêle aux autres, tout en les entremêlant. Cette plante filiforme dispose donc d’un formidable don d’entrelacement : pur mouvement textile, elle exprime avec maestria la fécondité de la « relation »[5]. Être liane, c’est pouvoir « traverser » des mondes multiples et se nourrir de ce que l’on traverse (et vice versa) – faire de la migration une puissance créatrice.
La liane nous invite à voir le monde sous la forme de lignes mouvantes plutôt que d’objets ou d’individus imperméables les uns autres : des lignes qui s’entremêlent dans les tissus de nos organes, de nos vêtements, de nos sociétés. Tout cela doit nous amener à penser autrement l’écologie : nous ne vivons pas « dans » un « environnement », nous sommes un ensemble de relations – des nœuds plutôt que des individus (Tim Ingold) –, dont le maillage constitue autant la texture de notre chair que celle des mondes que nous parcourons.
Le mouvement de la liane est à la fois philosophique et poétique, il obéit au principe du détour et de la correspondance : tout en variations créatrices, en zig zag, ici et là, par-dessus, par-dessous, par les interstices des rochers ou les tremplins des souches, la ligne de vie de la liane parcourt tous les étages de la forêt, sans priorité ni hiérarchie, enchâssant des formes de vie a priori sans rapport. Fourmis processionnaires, mantes religieuses, singes hurleurs, épiphytes chutant jusqu’au sol, mousses expansives, une multitude de vivants empruntent et recréent, à chaque instant, les routes fractales d’un monde « enliané ».
La liane désigne moins un être – une identité – qu’une certaine façon pour une pulsation végétale d’explorer et de dérouler un territoire au fil de son avancée
La liane désigne donc moins un être – une identité – qu’une certaine façon pour une pulsation végétale d’explorer et de dérouler un territoire au fil de son avancée, en y traçant des lignes inédites. L’écheveau aérien des lianes, tout comme le lacis souterrain des racines et du mycélium font de la forêt une toile mouvante, bien plus riche et complexe qu’INTERNET. C’est à un « Tout-monde » en constante réinvention que nous initie l’atelier textile des lianes : une cosmopoétique que menace la « mondialisation » – la consumation de la planète sous la forme morbide de la marchandise.
Le mot breton « lienaj », racine de « liane » et de « lyannaj », renvoie à la fabrication du tissu, aux savoir-faire textiles. Or le tissage est, selon Platon, l’art politique par excellence : rassembler, associer, relier des qualités, des groupes, des éléments hétérogènes en un seul et même tissu – une communauté politique – dont les contrastes rehausseront justement la richesse et la beauté. Dans le contexte de sociétés de plus en plus fragmentées (polarisations identitaires, explosion des inégalités, prolifération des frontières, etc.), c’est à la lumière du lyannaj que le projet « La sagesse des lianes » explorera de nouvelles façons de « faire monde » ensemble.
[1] « La vitalité des possibles face à l’extrême-droite au Brésil », Oiara Bonilla. https://www.terrestres.org/2018/11/15/la-vitalite-des-mondes-possibles-face-a-lascension-de-lextreme-droite-au-bresil/
[2] Cf. « Les bas-fonds du capital : L’éternel retour de l’Eldorado », Célia Izoard, in Revue Z, n°12, « Guyane : trésors et conquêtes », septembre 2018.
[3] Rapport de l’ONG Amazon watch : « Complicity in Destruction : How northern consumers and financiers enable Bolsonaro’s assault on the Brazilian Amazon » https://amazonwatch.org/news/2019/0425-complicity-in-destruction-2
[4] cf. Les îles du paradis, R. Grove.
[5] Au sens de la « poétique de la relation » d’Edouard Glissant ou des ontologies relationnelles de la nouvelle anthropologie (Viveiros de Castro, Arturo Escobar, Barbar Glowczewski, Anna Tsing, etc.).
Légende de la photo de couverture : Trans-Performance – Myriam Mihindou et Ibrahima Diop / Nkisi le miroir et la terre – l’anneau bleu /45 min – (c) F. Duconseille. Dans la pensée Kôngo, le Nkisi constitue l’incarnation d’une entité spirituelle qui se soumet à un contrôle humain au travers d’un rite. Les statues reproduisent une gestuelle codée pratiquée par les peuples des régions du grand fleuve Congo. Ce langage des gestes est complété par celui des yeux : comme les charges magiques qui sont fichées sur le ventre des personnages, les yeux sont recouverts de miroirs qui permettent d’avoir une ‘vision’ E.Toussaint
Philosophe